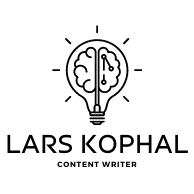J’ai tout plaqué pour les Philippines

En 2016, j’ai choisi de quitter définitivement la Suisse pour refaire ma vie sous les cocotiers. Mais rien ne s’est passe comme prévu…
Il est 9h30. L’heure d’un jus de calamansi (petits citrons verts locaux) sur le patio de la pension ou je loue un bungalow au mois pour le prix d’un jeu vidéo. Une pluie chaude tombe sur les palmiers, bananiers et palétuviers. Les oiseaux chantent quand même. Au loin, des coqs. Mon chien s’étire et vient me lécher la main. Plus tard, le soleil déchirera les nuages et la température dépassera les 30°C, comme tous les jours. Je suis à Puerto Princesa, capitale de Palawan, l’ile la plus à l’Ouest des Philippines. J’ai choisi de vivre ici, depuis trois ans. Je possède un food truck, stationné en bord de mer, à Port Barton, 150 km d’ici. Et je ne sais pas ce que je vais bien pouvoir en faire.
Dès le début de la pandémie, il y a cinq mois déjà, Palawan s’est coupée du monde. Tous les vols ont été supprimés, les lieux publics fermés, les routes barrées par des checkpoints tenus par l’armée. Tout s’est arrêté d’un coup, au début de la saison touristique, qui s’étend normalement de décembre à mai. Du jour au lendemain, à contrecœur, j’ai dû plier les parasols et boucler mon food truck, renvoyer mon équipe, me cloitrer à domicile avec un stock de nourriture et attendre un long mois avant d’être autorisé à ressortir, une heure par jour au début, masque sur le museau et autorisation officielle bien en vue, sous l’œil sourcilleux des volontaires locaux dont certains appréciaient un peu trop cette soudaine position d’autorité.
Port Barton, village de pêcheurs entre jungle et Mer de Chine, devenu depuis quelques années la seconde destination touristique de l’ile de Palawan, particulièrement prisée des backpackers pour son atmosphère détendue et conviviale, était devenue un village fantôme et poussiéreux. Même les chiens errants avaient presque tous disparus, morts de faim probablement. Çà et là, on croisait quelques touristes perdus, ayant choisi de s’échouer ici plutôt que de retourner dans leurs pays, ou la situation sanitaire était bien plus grave.
Car Palawan a jusqu’ici échappé presque entièrement au coronavirus qui continue de ravager les Philippines. Mais à quel prix… Pour une économie dont le développement dépendait en grande partie du tourisme, les conséquences sont déjà catastrophiques et l’avenir plus qu’incertain. Parmi la petite communauté expatriée qui faisait vivre et croitre Port Barton, certains espèrent encore pouvoir tenir d’une manière ou d’une autre, survivre – six mois, un an, deux peut-etre, jusqu’à un retour hypothétique et progressif, au mieux, de la manne touristique. D’autres, moins fortunés, cherchent à vendre. C’est mon cas. Comment en suis-je arrivé là ?
Rien à perdre
Je me souviens très bien de cet autre matin, en Suisse, ou j’ai finalement décidé de tout plaquer et de tenter le tout pour le tout. Il faisait beaucoup plus frais. Je m’étais mis moi-même dans une situation financièrement inextricable. Plusieurs changements professionnels successifs et un passage en indépendant m’avaient laissé avec une dette d’impôts impossible à éponger. Mon job à ce stade n’était plus qu’alimentaire, au sens propre : mon salaire suffisait à peine à couvrir les arriérés fiscaux (mais pas les impôts courants…) et après avoir payé les diverses charges, notoirement élevées en Suisse, il me restait juste assez pour remplir le frigo. Aucune amélioration à espérer, au contraire, un trou qui se creusait d’année en année. Heureusement, célibataire sans enfant, je n’étais, par choix, responsable depuis toujours que de moi-même. Mais était-ce vraiment comme cela que je voulais vivre ? Combien de temps encore allais-je pouvoir tenir ? Et qu’est-ce que j’avais à perdre ?
Ce matin-là, j’ai finalement décidé de donner ma démission et de quitter définitivement la Suisse et l’Europe en perdition. Je savais évidemment que je venais de prendre une des plus importantes décisions de ma vie – pour le meilleur ou pour le pire ? L’avenir le dirait.
Trois ans plus tard, la question reste ouverte. J’ai vécu bien plus intensément que si j’étais reste piégé dans la grisaille helvétique, connu des sommets de bonheur et des abimes d’angoisses, vu des merveilles et quelques horreurs, perdu autant d’argent que d’illusions, gagne des amis et beaucoup d’expérience. Conjuguer une expatriation et une reconversion n’est évidemment pas une sinécure. Sans aucune expérience de la restauration, des métiers de l’hospitalité ou du tourisme, et pas davantage des Philippines, des lois et règlements de ce pays, de ses habitants et de leurs mentalités… il était à peu près certain et inévitable que j’allais me planter. Et ça n’a pas manqué – mon premier essai, un restaurant en association avec un Philippin, fut un échec cuisant et couteux, mais instructif. Mes derniers sous ont servi à acheter un vieux jeepney, une sorte de minibus typique (les premiers furent fabriqués dans les années 50 à partir de jeeps militaires américaines recyclées, dont ils ont conservé le nom et la silhouette) et à le transformer en food truck. J’allais vendre des crêpes, des sandwiches grilles, des fruitshakes et des smoothies. Ça pouvait marcher.
Un rêve réalisé
Et ça a marché. La première saison fut un succès. Un emplacement idéal sur la plage de Port Barton. Des moments inoubliables. Le sentiment d’y être enfin arrivé, d’avoir concrétisé ce rêve, d’avoir fait réalité cette image de bar sous les cocotiers, jus de fruits et vahinés, que je fantasmais depuis si longtemps. J’étais heureux.
Et puis est arrivé la fin de la saison. Une tentative de transfert en ville, a Puerto Princesa, avec l’idée d’y séduire pendant six mois la clientèle locale, pas franchement couronnée de succès. Forte concurrence, nécessité de maintenir des prix aussi bas que possible, et surtout désintérêt des Philippins provinciaux pour tout ce qui n’est pas nourriture locale (riz) ou américaine (burgers)… Et toujours ces administrations kafkaïennes (mais version tropicale : avec le sourire en plus), ces règlements absurdes appliqués, ou pas, de manière aléatoire, ce flou incompréhensible et ces complications infinies. Un mois de démarches pour obtenir une prestation aussi basique en apparence qu’un raccordement électrique en plein centre-ville (j’ai fini par abandonner celui au réseau d’eau, de guerre lasse)… Et puis le Covid-19 qui a tout balayé.
Je ne suis pas venu ici par hasard. Les Philippines en général, et Palawan en particulier, sont d’une beauté à couper le souffle. Le potentiel touristique est immense. Avec près de 7000 iles et ilots, aucun pays au monde ne peut rivaliser en kilomètres de plages immaculées avec l’archipel philippin. Mais (surprise, surprise) derrière la carte postale ensoleillée, la réalité est plus complexe. Ce pays, profondément dysfonctionnel, est vraiment une étrange affaire.
Le paradoxe philippin
A l’origine, il n’y avait qu’un patchwork de tribus insulaires de pêcheurs-cueilleurs, dispersées et isolées les unes des autres (les Philippines comptent encore à ce jour 150 langues et dialectes), qui passeront progressivement à partir de l’an 1000 sous influence malaisienne et musulmane. Les Espagnols débarquent vers 1500, annexent l’archipel à leur empire colonial et imposent un catholicisme pur et dur mais n’arriveront jamais à soumettre l’extrême Sud, qui reste à ce jour musulman, séparatiste et pose une menace terroriste latente (voir le siege de Marawi, en 2017). L’Eglise et les ordres religieux tiendront le pays d’une main de fer pendant plus de trois siècles, et les Philippines représentent aujourd’hui la troisième plus importante population catholique au monde, derrière le Brésil et le Mexique. Toute idée de contrôle des naissances y reste sacrilège, la natalité est galopante, les écolières de province tombent souvent enceintes avant d’atteindre le collège. Les quelques familles ayant racheté les immenses biens fonciers et immobiliers de l’Eglise il y a 200 ans tiennent toujours le pays.
A la fin du XIXe, les Philippins se soulèvent et réclament leur indépendance, avec le soutien des Etats-Unis… qui rachètent a l’issue de la guerre l’archipel a l’Espagne et s’imposent en tant que nouveaux maitres, matent les indépendantistes dans le sang, massacrent 15% de la population dont toute l’élite hispanophone, et imposent l’anglais et la culture US, fast food, basketball et concours de beauté. A la fin de la Seconde guerre mondiale, la Manille espagnole a disparu sous les bombes américaines mais les Philippines obtiennent enfin leur indépendance. Rien ne change en réalité – 80% des membres du Congrès philippin sont issus de dynasties ou l’on est politicien de père en fils (ou en fille) depuis un siècle. A tous les échelons, de la présidence au gouvernement de province jusqu’ au plus petit barangay (village ou quartier), le pouvoir est une affaire héréditaire et la corruption, un système.
Le résultat de tout cela, c’est ce pays hybride où l’on a parfois l’impression d’être plus proche de Cuba que de la Chine. Un implant latino-américain au cœur du Sud-Est asiatique. Un pays où tout le monde parle anglais, ce qui facilite les choses en théorie, mais où rien ne fonctionne en pratique, peu importe le langage. Une culture anéantie puis reconstruite de bric et de broc par la colonisation, et pour cette raison probablement la plus ouverte d’Asie envers les occidentaux. Un pays qui m’a permis de réaliser mes rêves et ou j’ai tout perdu, un pays magnifique, chaleureux et hospitalier que je déteste parfois mais que j’aime aussi, et que je ne quitterai pas, malgré tout.
Il est 20h, l’heure du couvre-feu depuis le debut de cette interminable quarantaine. Les sirènes mugissent brièvement. Demain est un autre jour. Il fera beau et chaud, comme tous les jours, et les Philippins garderont le sourire.